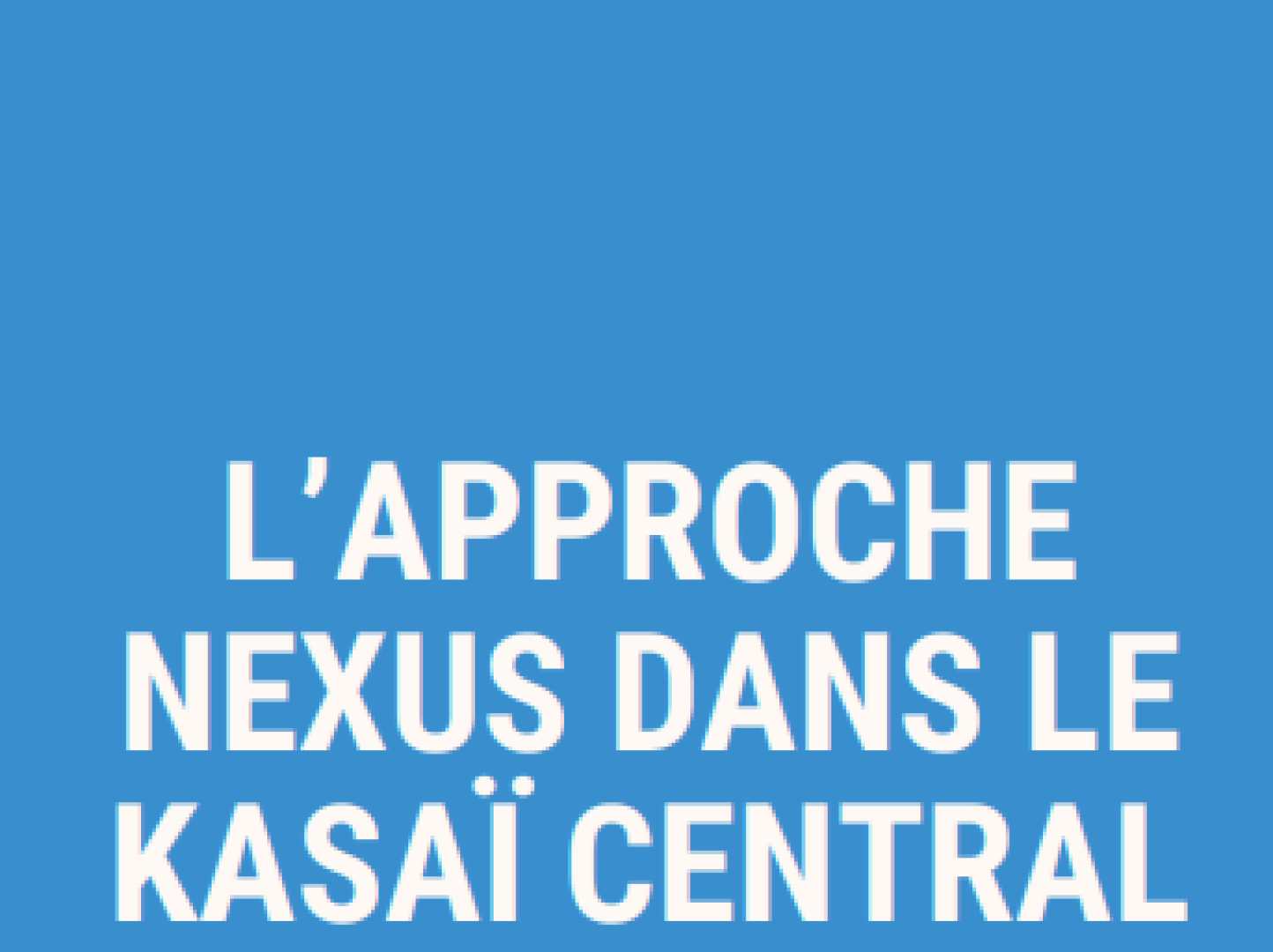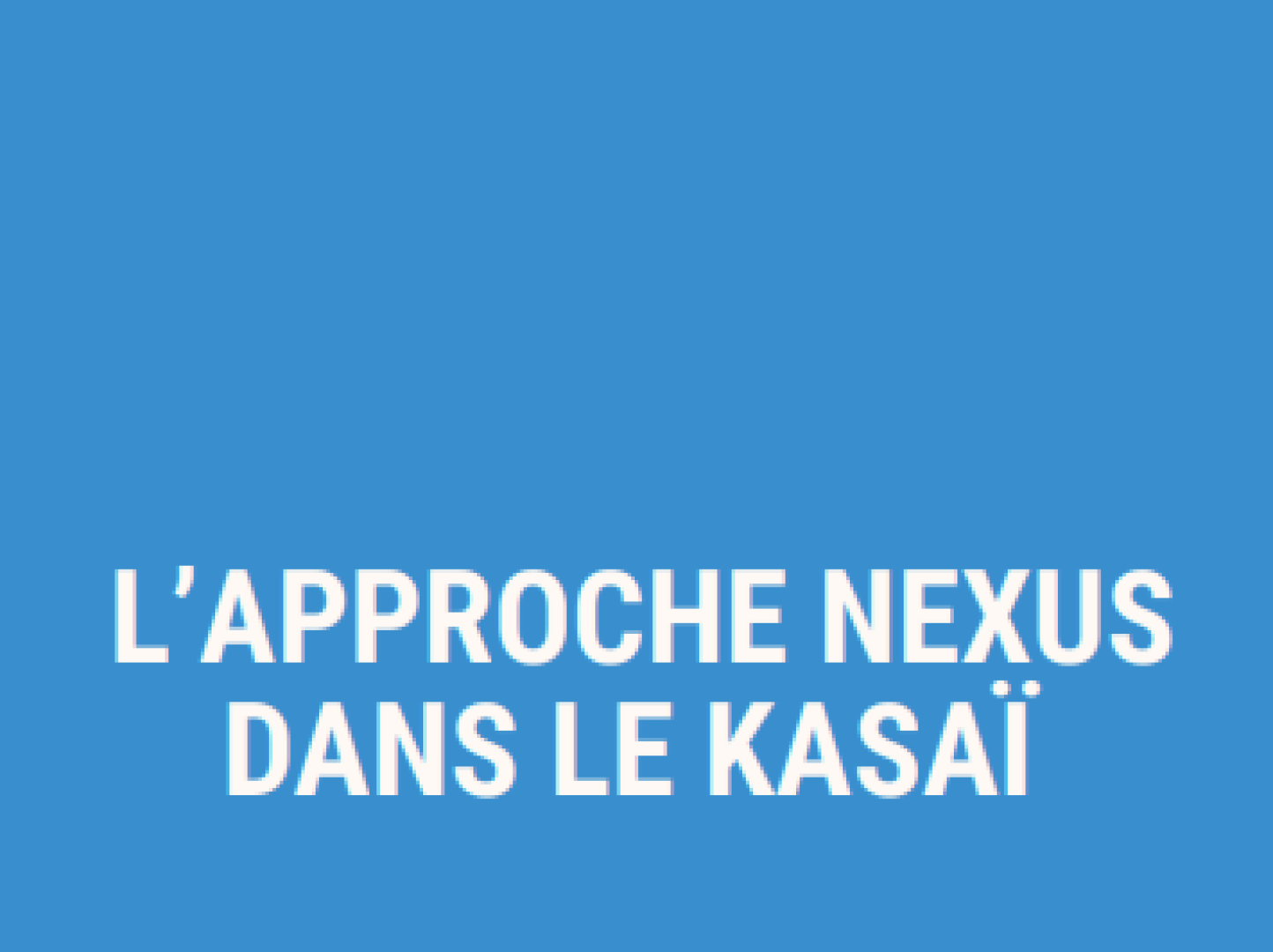Dernières actualités
Histoire
23 juin 2025
Les Nations Unies à la DRC Mining Week : mobiliser pour une exploitation minière responsable
Pour en savoir plus
Histoire
16 juin 2025
Renforcement des compétences techniques : l’ONUDI accompagne les formateurs congolais vers l’excellence
Pour en savoir plus
Histoire
16 juin 2025
Participation stratégique de l’ONUDI à la 6ᵉ édition du Katanga Business Meeting : Renforcer les synergies pour une formation qualifiante en RDC.
Pour en savoir plus
Dernières actualités
Organismes de l'ONU en RD Congo
Les objectifs de développement durable (ODD), également appelés objectifs globaux, constituent un appel universel à l'action visant à éliminer la pauvreté, à protéger la planète et à garantir à tous les peuples la paix et la prospérité. Ce sont aussi les objectifs de l'ONU en RD Congo.
Histoire
23 juin 2025
Les Nations Unies à la DRC Mining Week : mobiliser pour une exploitation minière responsable
Pendant trois jours, des agences, fonds et programmes onusiens ont occupé un stand conjoint au cœur de l’événement, aux côtés des entreprises du secteur privé. Cette participation témoigne des liens étroits entre les missions des Nations Unies et les enjeux du secteur minier en RDC. Les entités des Nations Unies ont, d’une seule voix, réaffirmé leur engagement en faveur d’un secteur minier plus responsable, plus inclusif et soucieux de ne laisser personne de côté. S’exprimant au nom des agences, en sa qualité de vice-président de l'Equipe Provinciale des Nations Unies au Haut-Katanga, Oumar Samake, Coordonnateur adjoint du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme en RDC, a souligné :« Nous sommes convaincus que des efforts conjoints et des partenariats solides peuvent contribuer à une dynamique d’exploitation minière plus responsable, respectueuse des droits humains, mais aussi génératrice d’opportunités dans le secteur. Cette semaine fut pour nous une opportunité de porter un plaidoyer commun, en mettant l’accent sur les problématiques liées à l’exploitation minière, ainsi que sur la nécessité de migrer vers une exploitation verte. Nous avons aussi exploré des pistes de solutions conjointes, notamment pour le secteur minier artisanal en RDC. »À travers diverses interactions, les agences ont présenté leurs missions et mandats respectifs, tout en illustrant la pertinence de leurs projets en cours en lien avec les enjeux du secteur minier. Elles ont rappelé leur rôle actif dans la promotion d’une chaîne d’approvisionnement minière responsable en RDC, notamment celui en lien avec les femmes et les enfants. « Les richesses extraites du sous-sol congolais doivent aussi contribuer à un avenir meilleur pour les enfants, en se traduisant par des progrès visibles dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la protection de l’enfance. » a rappelé Mariame Sylla, Représentante adjointe de l’UNICEF en RDC. Plusieurs panels de haut niveau réussissant des représentants de la société civile, des décideurs politiques, des acteurs du secteur privé, des représentants des missions diplomatiques ont été organisés. Des plaidoyers communs ont été formulés par les agences, tout en ouvrant la voie à de nouveaux partenariats, notamment dans les domaines de l’éducation, la protection des enfants, l’accès à l’encadrement de la femme et la jeunesse, la formation et l’employabilité. Pour le représentant de l’UNESCO en RDC, Isaias Barreto da Rosa; le secteur minier "est une locomotive du développement de la RDC, mais qui contraste avec l’image des villes et villages; pour lui l’urgence reste les formations pour le recrutement des populations locales, les services sociaux de base, la protection de l’environnement."Il rappelé le rôle des agences des Nations Unies dans et leur engagement à travailler avec le gouvernement et la société civile, et les entreprises minières, pour prendre en compte les population locales et les besoins des personnes moins favorisées. Il a été aussi mentionné que le développement d’une chaîne d’approvisionnement responsable ne se limite pas à la traçabilité des ressources. Il s’étend également à la promotion de la main-d’œuvre locale, à l’inclusion et à la création d’emplois décents pour les jeunes Congolais. Une vision pour une industrie minière plus inclusive, éthique et durable.Raef Melayeh, Coordonnateur du projet PAFEQ à l’ONUDI, a précisé :
« L’approche de l’ONUDI par exemple, repose sur le développement des compétences, notamment par le renforcement des capacités à travers des formations qualifiantes pour les jeunes Congolais. À travers le projet PAFEQ, nous visons à former une main-d’œuvre qualifiée dans le secteur de la maintenance des engins lourds, essentiels à l’exploitation minière. » Les activités de cette 20ᵉ édition de la DRC Mining Week se sont clôturées par l’allocution de Son Excellence Madame Judith Sunimwa, Première ministre de la République Démocratique du Congo, et sa visite sur différents stands, dont celui dédié au Système des Nations Unies. Elle s’est dite impressionnée par la présence active des agences onusiennes aux côtés des dynamiques minières, saluant l’initiative et encourageant les agences dans cette démarche collective.
« L’approche de l’ONUDI par exemple, repose sur le développement des compétences, notamment par le renforcement des capacités à travers des formations qualifiantes pour les jeunes Congolais. À travers le projet PAFEQ, nous visons à former une main-d’œuvre qualifiée dans le secteur de la maintenance des engins lourds, essentiels à l’exploitation minière. » Les activités de cette 20ᵉ édition de la DRC Mining Week se sont clôturées par l’allocution de Son Excellence Madame Judith Sunimwa, Première ministre de la République Démocratique du Congo, et sa visite sur différents stands, dont celui dédié au Système des Nations Unies. Elle s’est dite impressionnée par la présence active des agences onusiennes aux côtés des dynamiques minières, saluant l’initiative et encourageant les agences dans cette démarche collective.
1 / 5

Histoire
16 juin 2025
Participation stratégique de l’ONUDI à la 6ᵉ édition du Katanga Business Meeting : Renforcer les synergies pour une formation qualifiante en RDC.
Ce rendez-vous économique majeur a réuni des décideurs politiques, des chefs d’entreprise, des représentants de la société civile ainsi que des partenaires techniques et financiers, tous mobilisés pour discuter des leviers de développement durable en République Démocratique du Congo (RDC).La cérémonie d’ouverture, présidée par la Première ministre Judith Suminwa à Kolwezi, a mis en lumière l’importance du corridor de Lobito. Cette 6ᵉ édition du Katanga Business Meeting (KBM) a été une occasion de débats nourris et d’échanges enrichissants autour des perspectives de développement d’un avenir productif, collaboratif et durable pour la RDC.Les discussions ont mis en lumière l’importance de créer des ponts entre les différents écosystèmes économiques, institutionnels, éducatifs et industriels qui, ensemble, concourent à positionner la RDC parmi les nations émergentes.Dans ce cadre, l’ONUDI a présenté les avancées notables du Projet d’Appui à la Formation et à l’Emploi Qualifié (PAFEQ), mis en œuvre en partenariat avec le Gouvernement congolais. Ce projet vise à renforcer les compétences techniques des jeunes et des professionnels dans les domaines de la maintenance des engins lourds et des véhicules commerciaux, en réponse à la forte demande des entreprises installées dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba."À ce jour, trois programmes comprenant 20 modules et 31 compétences clés ont été conçus. Ils sont destinés aux apprenants du système éducatif, aux jeunes chercheurs d’emploi et aux professionnels. Ces derniers bénéficient déjà de formations continues dispensées par l’INPP Haut-Katanga. Les deux autres catégories y auront accès dans les jours à venir." explique Germain Kabanda, Expert national en Éducation et Formation Technique et Professionnelle au sein de l’ONUDI. Le PAFEQ s’appuie sur les compétences de 15 formateurs (9 issus de l’INPP et 5 de ITIMA et 1 du centre de ressources du Lualaba), renforcés tant sur le plan technique que pédagogique dans ces centres de formations en RDC, au Maroc, en Zambie et à Dubaï grâce à l'appui de partenaires industriels au projet SMT, Volvo et Epiroc.La participation de l’ONUDI au KBM aux côtés de l’INPP a permis de renforcer le dialogue et ouvert à des échanges avec le secteur privé sur les résultats concrets du PAFEQ, ainsi que sur les besoins spécifiques des entreprises en matière de main-d’œuvre qualifiée. Les échanges avec le secteur privé ont mis en évidence l’importance de créer des passerelles directes entre la formation professionnelle qualifiante et l’accès à l’emploi, notamment dans le secteur de la maintenance des engins lourds et des véhicules commerciaux.Le projet PAFEQ est financé par le Gouvernement suédois, avec un soutien technique de Volvo et Epiroc, et mis en œuvre par l’ONUDI en collaboration avec l’Institut National de Préparation Professionnelle (INPP) et le centre de formation ITIMA.
1 / 5

Histoire
16 juin 2025
Renforcement des compétences techniques : l’ONUDI accompagne les formateurs congolais vers l’excellence
Dans le cadre de son engagement en faveur du développement industriel inclusif et durable, l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) a soutenu, du 26 mai au 6 juin 2025, une session de formation technique de haut niveau au profit de six formateurs congolais, dont cinq issus de l’Institut Technique Industriel Manika (ITIMA) et du Centre de ressources du Lualaba (CDR). Cette formation s’est tenue à NORTEC, un établissement d'excellence situé à Ndola, en Zambie, avec l’appui du groupe Volvo.Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un partenariat dynamique entre les secteurs public et privé, facilité par l’ONUDI à travers les projets ZAMITA et PAFEQ (Projet d’Appui à la Formation et à l’Emploi Qualifié), financé par le Gouvernement suédois. Elle illustre concrètement la volonté de créer des synergies transfrontalières pour renforcer la qualité de la formation professionnelle dans des domaines clés de l’économie.Former les formateurs pour mieux préparer la jeunesse L’objectif de cette session intensive était double : renforcer l’expertise technique des participants et perfectionner leurs compétences pédagogiques. Les modules ont porté notamment sur :La décomposition et l’assemblage des transmissions à train planétaire ;La maîtrise des transmissions hydrauliques série E ;L’amélioration des techniques de transmission du savoir.En dotant ces formateurs d’outils à la pointe de la technologie, le PAFEQ vise à garantir que les jeunes congolais, en particulier ceux âgés de 15 à 35 ans, bénéficient d’une formation qualifiante, adaptée aux exigences actuelles du marché de l’emploi, notamment dans le secteur stratégique de la maintenance des engins lourds et véhicules commerciaux.Un impact durable pour les communautés localesAu-delà des compétences techniques transmises, cette initiative porte une ambition sociale et économique plus large. Elle vise à :Réduire le chômage des jeunes en leur offrant une formation pertinente, en phase avec les besoins réels du secteur industriel ;Renforcer les institutions locales d’enseignement technique en y introduisant des standards internationaux ;Stimuler le développement économique régional à travers une main-d'œuvre plus compétente, apte à répondre aux exigences des entreprises minières et logistiques.Le PAFEQ, d’une durée de cinq ans, représente un modèle exemplaire de Partenariat Public-Privé de Développement (PPPD) entre la République Démocratique du Congo, la Suède, Volvo Group, Epiroc et l’ONUDI. Il symbolise une approche inclusive, orientée vers l’action, qui mise sur la formation comme levier de changement et d’autonomisation des communautés.Un avenir plus prometteur grâce à des partenariats solidesEn investissant dans les compétences locales, l’ONUDI et ses partenaires contribuent à bâtir une économie plus résiliente, plus équitable et plus compétitive. Cette formation en Zambie n’est pas une fin en soi, mais le début d’un cycle vertueux où les formateurs deviennent les vecteurs de transformation pour toute une génération.
1 / 5

Histoire
05 juin 2025
Journée portes ouvertes des Nations Unies à Lubumbashi : un dialogue renforcé avec la société civile
L’équipe multi-provinciale du système des Nations Unies (UNMPT), composée des agences, fonds et programmes actifs dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba, a organisé une journée portes ouvertes à l’intention des acteurs de la société civile. L’objectif principal était de présenter les mandats, missions et projets en cours dans la région, afin de favoriser une meilleure compréhension du rôle des Nations Unies sur le terrain et de renforcer les synergies locales.Un espace de dialogue et de compréhension mutuellePrès de soixante représentants de la société civile et partenaires des agences des Nations Unies ont pris part à cette journée d’échange. L’événement a été conçu comme un espace de dialogue constructif, axé sur les enjeux du développement durable dans le contexte congolais."Le but était d’instaurer un dialogue avec les acteurs de la société civile, de donner la parole à toutes les agences présentes ici, d’expliquer leurs mandats, leurs missions, et les activités réalisées. Surtout, nous voulions identifier comment nous pouvons être complémentaires dans ce contexte de réduction des ressources à l’échelle mondiale." Oumar Samaké, Chef de bureau des Nations Unies aux Droits de l'Homme pour le Katanga et vice-président de l’équipe multi-provincialeUne interaction directe et transparenteAu fil des discussions, les participants ont posé de nombreuses questions, auxquelles les différentes agences ont répondu avec transparence. Cette interaction a permis de clarifier les rôles et dissiper certaines méconnaissances.Agnès Assumani, coordinatrice du Programme d’appui aux Albinos dans le Haut-Katanga, a partagé son appréciation :"Personnellement, j’ai découvert l’existence des agences, dont j’ignorais les mandats et missions. En tant que membre de la société civile, une activité comme celle-ci ouvre des perspectives de collaboration. Tous, à l’unanimité, avons eu une vision plus claire pour pouvoir nous aligner et chercher des solutions ensemble."Une dynamique de collaboration à pérenniserUn consensus s’est dégagé parmi les participants : la nécessité d’organiser ce type de rencontre chaque semestre, afin de permettre un meilleur alignement et suivi des activités du système des Nations Unies dans les deux provinces.Cette initiative s’inscrit pleinement dans le cadre de coopération entre le gouvernement de la RDC et les Nations Unies, en cohérence avec les Objectifs de développement durable (ODD). Toutes les actions menées sont alignées avec les priorités nationales.L’événement a ainsi permis aux organisations de la société civile, considérées comme de véritables incubateurs de solutions locales de mieux s’orienter, de renforcer leur rôle dans la mise en œuvre des objectifs de développement et d'identifier des pistes concrètes de collaboration avec le système des Nations Unies.Pour le vice-président de l’équipe multi-provinciale du système des Nations Unies cette activité a témoigne de la cohésion et la collaboration entre les agences ; Il a salué la participation active de chacune, soulignant le rôle clé de la FAO, dont le soutien financier a largement facilité l’organisation de l’activité.
1 / 5

Histoire
07 mai 2025
Renforcer la sécurité de proximité à Kimbanseke : vers une police au service du citoyen
La commune de Kimbanseke (Est de Kinshasa) a récemment accueilli un atelier structurant dans le cadre de la deuxième phase du projet « Professionnalisation de la Police pour la Population et la Paix » (P4P), mis en œuvre conjointement par ONU-Habitat et l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), avec la participation active de la Police Nationale Congolaise (PNC) et des autorités nationales et locales. En réponse aux défis sécuritaires persistants dans cette commune densément peuplée, l’initiative vise à améliorer durablement la collaboration entre les forces de l’ordre et la population. L’atelier s’inscrit dans une série d’activités structurées autour de la formation, du dialogue communautaire, et de la mise en place du Conseil Local de Sécurité de Proximité (CLSP). À travers cette démarche inclusive, les participants – issus des services communaux, de la société civile, de la police et des structures communautaires – ont été outillés sur des thématiques clés telles que l’andragogie, le civisme, la gestion participative des ressources et l’entretien des infrastructures publiques. L’un des points forts de cette initiative réside dans la reconnaissance et l’implication active des acteurs nationaux dans le processus. Qu’il s’agisse des autorités communales, des chefs de quartiers, ou des membres des organisations communautaires, tous ont été mobilisés pour définir ensemble un Plan Local de Sécurité pertinent et adapté aux réalités de Kimbanseke. Le projet renforce ainsi les capacités des institutions nationales et locales, tout en plaçant les communautés au cœur du changement.L’opérationnalisation du CLSP permettra non seulement de pacifier les quartiers, mais également de restaurer la confiance entre la police et les citoyens. Ce climat de confiance est un préalable essentiel à la stabilité, à la cohésion sociale et à l’amélioration du cadre de vie. En mettant un accent particulier sur les groupes vulnérables – notamment les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap – le projet contribue à bâtir une société plus inclusive, plus sécurisée, et tournée vers la paix durable.Ce partenariat exemplaire entre la JICA, ONU-Habitat et les institutions congolaises illustre la force du dialogue et de la coopération pour répondre efficacement aux défis sécuritaires urbains. À travers des actions concrètes et une approche participative, Kimbanseke se positionne aujourd’hui comme un laboratoire de bonnes pratiques en matière de gouvernance locale et de sécurité de proximité.
1 / 5

Communiqué de presse
20 mai 2025
Communiqué Conjoint sur la mise en œuvre du nexus humanitaire, développent et paix (HDP) dans la province du Kasaï
La province du Kasaï a tenu son ‘’Dialogue stratégique pour le renforcement de l’approche Nexus avec l’Etat au centre’’, à Tshikapa, du 14 au 15 mai 2025. Faisant suite à la relance de l’approche nexus HDP par le Gouverneur de province, les présents travaux ont connu la participation du Vice-Gouverneur et Gouverneur intérimaire, du Vice-Président et Président intérimaire de l’Assemblée Provinciale, des Députés provinciaux, des ministres provinciaux, de la délégation conjointe du Ministère du Plan et de la Coordination de l’Aide au Développement, conduite par le Secrétaire Général, des représentants du groupe de bailleurs du Nexus, notamment les Ambassades d’Allemagne, de Belgique, de Suède, et du Bureau du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies. Ces assises ont été une opportunité d’échanger avec les acteurs du terrain, à savoir les représentants du système de Nations Unies, de la société civile, du secteur privé, des ONGs nationales et internationales, ainsi que les experts et chefs de division de l’administration publique, sur les résultats concrets de l’approche Nexus HDP et les approches de travail pour aligner les efforts autour du plan de développement provincial du Kasaï, comme cadre stratégique fédérateur.La composition de la délégation conjointe et la participation au niveau de la province se révèlent une occasion historique, réunissant le gouvernement central, les partenaires techniques et financiers, le gouvernement provincial, le système des Nations Unies et la société civile, dans une province pilote, où l’approche Nexus est mise en œuvre depuis 2022. Cette approche intégrée a déjà permis d’enregistrer des résultats concrets, notamment une réduction mesurable de l’insécurité alimentaire, une augmentation de l’accès aux services sociaux de base et une baisse des cas de violences basées sur le genre.Afin d’avoir un aperçu de ces résultats, la délégation a également visité une intervention qui s’inscrit dans les efforts engagés par le gouvernement dans le cadre du projet de justice transitionnelle ‘’PROJUST’’. Ce projet soutenu par le Fonds pour la consolidation de la paix (PBF), lancé récemment, capitalise sur des interventions antérieures visant la réconciliation communautaire et la formation des réseaux des femmes championnes dans la promotion de la cohésion sociale ; il illustre de manière concrète l’opérationnalisation du Nexus dans le contexte local. La délégation a également eu l’opportunité de visiter le pôle de convergence de Shamusanda, afin de découvrir une autre initiative concrète mise en œuvre à travers l’approche Nexus. Cette initiative, menée conjointement par le HCR, la FAO et le PAM, intègre des mécanismes alternatifs de résolution des conflits au sein des communautés bénéficiaires.Il faut rappeler que, dans une perspective de renforcement de la coordination entre les gouvernements central et provincial et leurs partenaires, le Ministère du Plan et de la Coordination de l’Aide au Développement a récemment acté la mise en place d’un Groupe Consultatif Nexus (GCN) pour appuyer l’opérationnalisation de l’approche nexus en lien avec le Plan national stratégique de développement (PNSD) 2024-2028.La dynamique du Kasaï présente des opportunités stratégiques pour continuer la réflexion conjointe sur le renforcement de la collaboration entre les différents acteurs des 3 piliers Humanitaire, Développement et Paix, pour plus de coordination, plus de synergie et plus de complémentarité, afin de générer un impact durable sur le terrain et améliorer les conditions de vie des populations locales à travers une approche intégrée et coordonnée.
1 / 5
Communiqué de presse
12 avril 2025
La République Démocratique du Congo à nouveau éligible au Fonds pour la consolidation de la paix
‘’À travers ce soutien, le Fonds poursuivra son engagement aux côtés du Gouvernement congolais pour renforcer les capacités nationales de consolidation de la paix, en veillant à pérenniser les acquis. L’appui sera mis en œuvre à travers des initiatives portées par l’équipe de pays des Nations Unies et ses partenaires, en alignement avec le Cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable pour la période 2025–2029.’’ Ecrit Antonio Guterres.Le PBF est un mécanisme de financement du Secrétaire Général des Nations Unies visant à contribuer au relèvement en faveur de la consolidation de la paix, à travers le monde. Pour ce qui est de la RDC, les interventions dans le cadre de ce Fonds appuient depuis 2009 le renforcement de la gouvernance, la cohérence des mécanismes de consolidation de la paix et la prévention des conflits.Pour le Système des Nations Unies en RDC, ‘’la rééligibilité de la République Démocratique du Congo au Fonds pour la Consolidation de la Paix constitue un signal fort, soulignant l'importance de maintenir une attention particulière au domaine de la consolidation de la paix dans un contexte financier global complexe. Cette reconnaissance offre un nouvel élan aux efforts que nous déployons, en collaboration avec nos partenaires et aux côtés du Gouvernement, pour soutenir les communautés, notamment les personnes les plus vulnérables. En s’appuyant sur leurs potentiels, ces communautés peuvent mieux aborder les causes profondes des conflits et progresser, grâce aux actions appuyées par le PBF, sur la voie de la paix, condition indispensable à la réalisation des Objectifs de Développement Durable.’’, a dit Monsieur Adama Moussa, Coordonnateur Résident par intérim des Nations Unies en RDC.‘’Je me réjouis de l’aboutissement de ce processus qui donne lieu à un nouveau cycle qui se veut une mise à l’échelle des acquis des cycles précédents avec un engagement structurel plus fort et holistique. Il aura la particularité d’accompagner le gouvernement dans ses efforts en matière de prévention de la violence ainsi que des conflits en mettant l’accent sur la rationalisation des programmes et autres mécanismes existants pour plus d’efficacité’’ a déclaré le Vice-Premier Ministre, ministre du Plan et de la Coordination de l’Aide au Développement, en sa qualité de Co-Président du Comité de Pilotage du PBF.Au cours du cycle passé, de 2019 à 2024, avec 22 projets évalués à 49 millions de dollars américains, le PBF a appuyé des activités dans les provinces du Kasaï, Kasaï Central, Sud-Kivu et Tanganyika, en faveur de la cohésion sociale, la gouvernance locale inclusive, la réintégration communautaire, la prévention des conflits, la transition liée au désengagement de la MONUSCO, ainsi qu‘au programme du gouvernement pour le désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (P-DDRCS).Pour ce nouveau cycle, trois axes prioritaires ont été validés par le Comité de Pilotage du PBF, notamment : Le renforcement de la gouvernance et la cohérence des mécanismes de consolidation de la paix et de prévention des conflits ;Le soutien à la résilience des communautés et populations les plus vulnérables aux conflits en promouvant des solutions durables et en abordant les causes profondes, en particulier celles liées aux ressources naturelles, minières et foncières ;Le renforcement de la protection des civils, la sécurité, les droits humains et la justice, y compris transitionnelle, dans la perspective de la transition liée au désengagement progressif et responsable de la MONUSCO.Selon la procédure habituelle du Fonds, de nouvelles initiatives seront identifiées au fur et à mesure, sur la base des allocations annuelles communiquées par le Bureau d’appui à la consolidation de la paix (PBSO) à New York, sous l’égide des co-présidents du Comité de Pilotage National du PBF en RDC et avec l’appui du Secrétariat Conjoint du PBF basé à Kinshasa.
1 / 5
Communiqué de presse
27 février 2025
Lancement du plan de réponse humanitaire 2025
Le Gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) et la communauté humanitaire lancent ce jour le Plan de réponse aux besoins humanitaires 2025, afin de mobiliser 2,54 milliards de dollars. Cette enveloppe est cruciale pour fournir une aide vitale à 11 millions de personnes – dont 7,8 millions de déplacés internes, l’un des niveaux les plus élevés au monde – parmi les 21,2 millions de Congolais affectés par des crises multiples : conflits armés, catastrophes naturelles et épidémies.Le lancement du Plan de réponse aux besoins humanitaires pour la RDC intervient dans un contexte particulier de polycrise multidimensionnelle d’une ampleur inédite, qui combine trois éléments déstabilisateurs majeurs : d’une part une spirale de violence qui s’étend de l’Ituri au Tanganyika ; d’autre part la présence d’une autorité de facto dans des zones clés du Nord-Kivu et du Sud-Kivu – deux provinces où les besoins humanitaires sont très importants ; et enfin une crise majeure du financement de la réponse humanitaire. « Tous les signaux d’alerte sont au rouge. Mais même face à ces défis énormes, l’action humanitaire démontre chaque jour son efficacité pour sauver des vies. Notre seule mission est de porter assistance aux populations les plus vulnérables, où qu’elles se trouvent. Nous devons nous adapter pour continuer à fournir cette aide vitale, sans jamais compromettre les principes fondamentaux qui guident l’action humanitaire : neutralité, impartialité, indépendance et humanité », déclare Bruno Lemarquis, Coordonnateur humanitaire en RDC. En 2025, la réponse humanitaire vise à satisfaire les besoins les plus urgents et à alléger les souffrances des personnes affectées en apportant une assistance rapide, efficace et adaptée aux contextes les plus critiques. Le plan prévoit, par exemple, de prendre en charge 1,5 million d’enfants souffrant de malnutrition aiguë, de garantir l’accès à l’eau potable pour cinq millions de personnes, et de lutter contre des épidémies telles que le choléra, la rougeole et le Mpox. Parallèlement, le plan soutiendra le retour des familles déplacées, la relance des moyens de subsistance, et la préparation aux chocs climatiques. Dans un contexte marqué par des violences extrêmes, la protection des civils et des plus vulnérables, tels que les femmes et les enfants, restera une priorité absolue dans toutes les interventions. Cependant, la forte diminution des contributions met en péril l’aide humanitaire. En 2024, grâce à un financement record de 1,3 milliard de dollars, 7,1 millions de personnes ont pu bénéficier d’une assistance humanitaire. En 2024, la contribution des États-Unis d’Amérique, l’un des principaux bailleurs de l’aide humanitaire, a couvert 70 % du financement du plan de réponse humanitaire en RDC. "Nous sommes à un moment charnière. Sans une mobilisation internationale accrue, les besoins humanitaires exploseront, la stabilité régionale sera davantage menacée, et notre capacité d’intervention sera gravement compromise », souligne M. Lemarquis.La communauté humanitaire appelle le Gouvernement congolais, la communauté internationale, et les partenaires humanitaires nationaux et internationaux à un sursaut collectif pour, ensemble, mettre en œuvre ce plan de réponse avec les moyens, les accès et les soutiens nécessaires. « L’assistance humanitaire est essentielle pour sauver des vies. Toutefois, elle n’est pas la solution. Les véritables solutions sont avant tout politiques et résident dans des actions ciblées et durables pour s’attaquer aux causes profondes des conflits », rappelle M. Lemarquis.
1 / 5
Communiqué de presse
06 décembre 2024
Le Gouvernement et le Système des Nations Unies en République démocratique du Congo signent le nouveau cadre de coopération pour le cycle 2025 – 2029
La Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, Coopération Internationale et Francophonie, Son Excellence Mme Thérèse Kayikwamba Wagner, et le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies en République démocratique du Congo, M. Bruno Lemarquis, ont signé vendredi, à Kinshasa, le nouveau cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable pour les cinq prochaines années, couvrant la période 2025 – 2029. Cette signature est intervenue après validation conjointe du contenu de ce document stratégique, reprenant les priorités des Nations Unies en appui à celles du Gouvernement. ‘‘Le Cadre de Coopération que nous signons aujourd’hui est bien plus qu’un document. C’est une feuille de route ambitieuse, co-construite avec toutes les parties prenantes, pour accompagner la RDC dans la réalisation de son Programme national stratégique de développement et de sa vision pour l’accélération de la mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable’’ a précisé M. Bruno Lemarquis. Le nouveau cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable s’articule autour de 4 axes d’interventions, définis en lien avec les domaines prioritaires du Plan National Stratégique de développement (PNSD). Ces quatre axes portent sur : La croissance économique inclusive durable, tirée par une économie plus diversifiée, génératrice d’opportunités d’emplois et de revenus décents (plus particulièrement pour les populations les plus vulnérables) et d’effets sur l’inclusion sociale et territoriale La gouvernance efficace, Etat de droit et protection des populations au service d’un développement inclusif et d’une paix durable en RDCL’accès aux services sociaux de base de qualité, de protection sociale inclusive et renforcement des capacités pour tous et plus particulièrement pour les plus vulnérables, pour leurs besoins de résilience, de solutions durables et de développementLa gestion durable des ressources naturelles, protection des écosystèmes et gouvernance environnementale efficace et transparente‘’La grande innovation du nouveau cadre de coopération est d’orienter les interventions vers l’appui aux politiques et aux réformes à caractère réellement transformateur, y compris à travers des interventions visant à s’attaquer à certaines des causes sous-jacentes des conflits, avec une logique de convergence. Cette logique vise à renforcer les synergies et la complémentarité de l’expertise de nos agences, fonds et programmes dans le cadre de la mise en œuvre de certains programmes pour plus d’impact.’’ a précisé le Coordonnateur résident. ‘’Ce partenariat tombe à point nommé puisque le Système des Nations Unies va accompagner les efforts de notre pays pour atteindre les ODD qui ont été mis en mal par plusieurs facteurs tant endogènes qu’exogènes. C’est dans ce contexte que le Gouvernement de la RDC, à travers cet accord de partenariat, ambitionne de jeter les bases d’un développement socioéconomique harmonieux et inclusif pour construire une économie diversifiée à croissance inclusive qui intègre une dimension humaine et ne laisse personne de côté, en particulier les groupes vulnérables.’’ a déclaré la Ministre d’Etat, Ministre des affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba Wagner. Présidant cette cérémonie de signature, le Vice-premier, Ministre du Plan et de la Coordination de l’Aide au Développement, Guylain Nyembo, a souligné, qu’‘’Adoptant une approche inclusive, intégrée et multisectorielle, en phase avec l’action du Gouvernement, ce Cadre de coopération a donc été agréé pour renforcer les capacités gouvernementales dans la mise en œuvre de réponses à la fois immédiates et structurelles, vis-à-vis des défis énumérés. Il offre une réelle opportunité de renforcer la coopération existante en matière de développement à travers des actions davantage concrètes et bien plus efficaces.’’ L’équipe de pays des NU est composée de 23 Entités (Fonds, Programmes, Agences et Mission de maintien de la paix) des Nations Unies résidentes en RDC. Au total 29 entités (dont 3 institutions résidentes apparentées et 3 agences non-résidentes) ont des interventions dans le pays.
1 / 5
Communiqué de presse
23 août 2024
Le gouvernement congolais, les Nations Unies et les partenaires s’engagent à contribuer au financement de la Feuille de route de la Transition au Sud- Kivu
Le Gouvernement de la République démocratique du Congo et les Nations Unies saluent la tenue de l’atelier d’alignement des contributions au financement de la Feuille de route relative au désengagement de la Mission de Stabilisation de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUSCO) qui a eu lieu à Bukavu du 13 au 14 août. Cet atelier marque une étape importante dans la consolidation de la transition du transfert de responsabilités au Gouvernement au Sud-Kivu conformément aux résolutions 2717 (2023) et 2746 (2024).L’Equipe Provinciale Intégré de Transition (EPIT) a élaboré cette feuille de route en 2024 afin d’identifier les activités clés à mener par le gouvernement pour assurer le transfert réussi des tâches de la MONUSCO dans le contexte de son désengagement. La feuille de route, chiffrée à 57 millions de dollars américains, a été validée au niveau national conjointement par le gouvernement et la MONUSCO en juin 2024.Le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et de la Coordination de l’Aide, M. Guylain Nyembo et le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général, Coordonnateur résident et Coordonnateur humanitaire du Système des Nations Unies en RDC, M. Bruno Lemarquis, ont participé en visioconférence au lancement de l’atelier depuis Kinshasa. Dans son allocution, le Vice-Premier Ministre a salué l’initiative de cet atelier d’alignement qui se veut une réponse aux défis relevés par le Rapport Conjoint relatif à la réalisation de la première phase du plan de désengagement de la MONUSCO. Il a également annoncé l’engagement du Gouvernement à mobiliser un peu plus de 50% du budget total attendu, soit un montant de 30 000 000 de dollars américains dont la répartition sera à considérer dans le cadre des travaux du Secrétariat Technique. Pour le reste des ressources nécessaires pour la feuille de route, le gouvernement est engagé à mobiliser les fonds nécessaires soit directement soit à travers ses partenaires.Pour sa part, M. Lemarquis a déclaré que les Nations Unies ont développé un plan d’appui qui visera surtout au renforcement des capacités des entités étatiques concernées. ''Je voudrais particulièrement souligner et saluer chaleureusement le travail mené par le système des Nations Unies afin de concrétiser leur contribution à la mise en œuvre de la Feuille de Route par le biais du Plan d’appui des Nations Unies à la transition au Sud-Kivu, qui s’élève à 23 millions de dollars'' a dit M. Lemarquis. M. Lemarquis a ajouté que le système des Nations Unies est en train d'identifier et de mobiliser les ressources nécessaires à son plan d'appui.De son côté le gouverneur du Sud Kivu, M. Jean Jacques Purusi a chiffré la contribution de la province à près de 2,5 millions de dollars dont 1,5 millions déjà dépensés en termes de contribution dans le renforcement de la présence des Forces de Défense et de Sécurité notamment dans les bases anciennement occupées par la MONUSCO, le paiement de loyers des terrains des particuliers repris par le gouvernement, la prise en charge de la ration alimentaire des éléments déployés, le renforcement de l’autorité de l’Etat de droit par l’organisation des chambres foraines, la dotation des bureaux au PDDRCS, la réhabilitation des routes d’accès aux points chauds, la construction des quais et autres.Au cours des travaux dans les quatre groupes de l’EPIT, plusieurs partenaires techniques et financiers et les ONG internationales ont démontré, à travers certaines activités prioritaires, leur intérêt à y participer pour la mise en œuvre de la feuille de route. Le processus pour confirmer les partenaires et les ressources disponibles pour la feuille de route se poursuivront.
1 / 5
Dernières ressources publiées
1 / 11
Ressources
02 août 2024
1 / 11