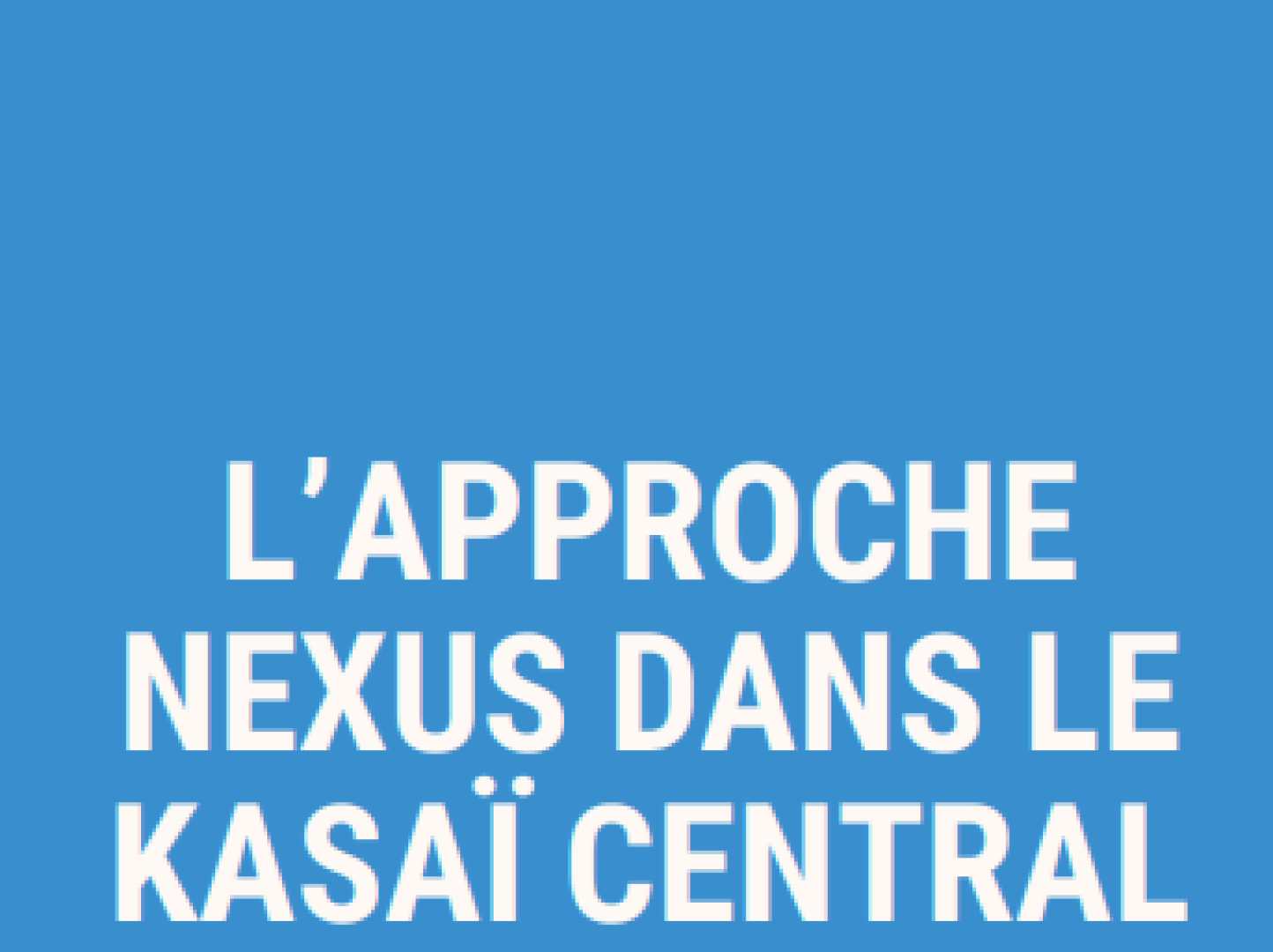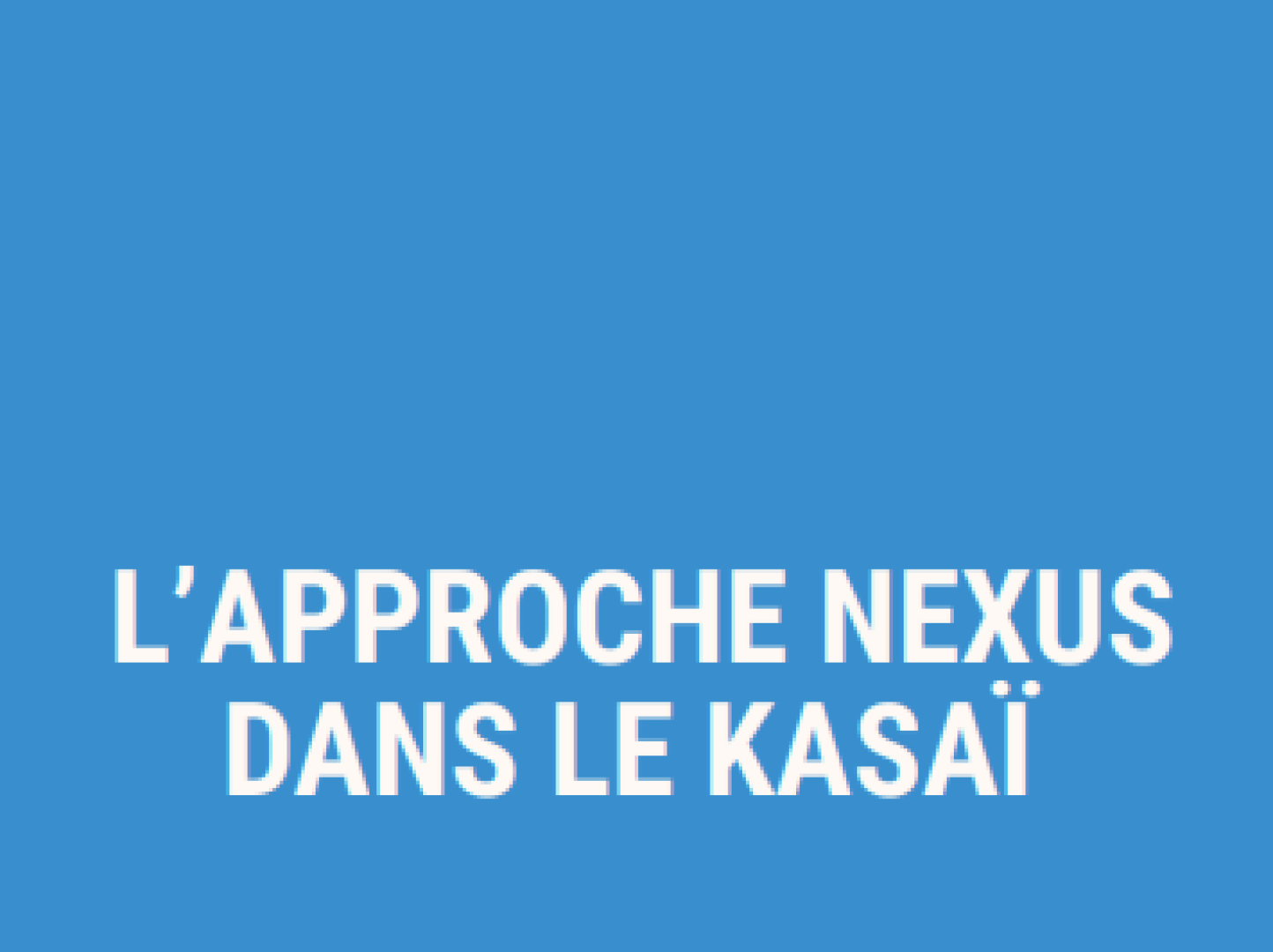Dernières actualités
Histoire
11 décembre 2025
Mariane Kimingu, Femme maraîchère et bénéficiaire du projet AVENIR
Pour en savoir plus
Histoire
11 décembre 2025
Le FIDA et le FEM s’engagent à restaurer 9000 hectares de terres boisées des Paysages du Miombo
Pour en savoir plus
Histoire
11 décembre 2025
UNFPA et la Fondation Vodacom lancent l’Académie de Leadership Féminin en RDC
Pour en savoir plus
Dernières actualités
Organismes de l'ONU en RD Congo
Les objectifs de développement durable (ODD), également appelés objectifs globaux, constituent un appel universel à l'action visant à éliminer la pauvreté, à protéger la planète et à garantir à tous les peuples la paix et la prospérité. Ce sont aussi les objectifs de l'ONU en RD Congo.
Histoire
11 décembre 2025
UNFPA et la Fondation Vodacom lancent l’Académie de Leadership Féminin en RDC
Après une phase pilote menée avec succès à Kinshasa et Lubumbashi, l'académie de leadership féminin (ALF) initiée par UNFPA est passe à l'échelle nationale à travers une phase digitale. Ce programme d'autonomisation des adolescentes et jeunes filles, mis en place par UNFPA depuis 2021 et qui sera piloté dans cette nouvelle phase en partenariat avec la Fondation Vodacom, repose sur un modèle hybride innovant qui combine le mentorat en présentiel par la création de clubs de jeunes filles dans les écoles, encadrés par des mentors et une composante digitale hébergée sur la plateforme VodaEduc qui offre des modules interactifs, des vidéos inspirantes et un mentorat virtuel assuré par des femmes leaders. Un programme ambitieuxL’Académie de leadership féminin est une approche innovante de préparation des filles à la vie publique, particulièrement à l’exercice du leadership. Il a l’ambition de susciter et promouvoir depuis l’adolescence, l’acquisition d’un certain nombre de valeurs et de qualités qui sous-tendent cette posture. Cela, notamment à travers le mentorat et le coaching ainsi que la participation à une série d’activités parascolaires. Avec l’appui des coaches et mentors, les élèves seront amenées à réaliser des conférences-débats, des vidéos-forum, des focus groupes. Ces activités sont destinées à les exposer régulièrement aux exigences administratives ainsi qu’aux défis relationnels, émotionnels et logistiques liés à l’organisation des grands évènements. Dans cette même dynamique, elles seront également encouragées à briguer des postes de responsabilité en classe, à l’école ou en communauté à travers les mouvements et associations. La cérémonie de cette nouvelle phase de l’académie de leadership féminin a eu lieu à Kinshasa en présence du Sous-secrétaire général des Nations Unies chargé de la Jeunesse, en visite officielle à Kinshasa. Occasion pour Felipe PAULLIER, de rappeler que cette initiative n’est pas seulement un programme, mais bien plus un mouvement pour accorder un espace aux jeunes filles pour renforcer leurs compétences intellectuelles et transformer leurs vies. Car, la capacité de s’épanouir se trouve dans chacune d’elles », a-t-il martelé.La conseillère spéciale du Chef de l’Etat en matière de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et la traite des personnes, Mme Chantal YELU MULOP qui a procédé au lancement officielle de l’ALF, a appelé les parents, les encadreurs des filles et les mentors, à profiter de cette plateforme pour construire une génération des jeunes conscientes de leur rôle dans un monde égalitaire.D’autres allocutions prononcées au cours de cette cérémonie, ont démontré l'importance cruciale de cette initiative pour l'avenir de la RDC. L’Ambassadeur de la Norvège en RDC, a pour sa part, encouragé les jeunes filles à saisir cette opportunité pour devenir les moteurs du changement :Je suis plein d’optimisme et d’espoir. À toutes les jeunes filles, je vous dis : vous êtes l’avenir. Vous avez le potentiel de devenir les moteurs du changement et de défier les rôles de genre traditionnels. Cette académie peut vous aider à relever ce défi important. » a-t-il dit.Au nom de la Fondation Vodacom, Mme Agnès Muadi, membre du Conseil d’Administration et Directrice des ressources humaines de Vodacom Congo, a déclaré avec conviction queLe leadership féminin n’est ni une option, ni un slogan. C’est une priorité ; c’est une nécessité ; c’est l’avenir même de notre pays. Aujourd'hui, avec UNFPA, nous faisons naître une lumière qui doit guider chaque femme congolaise qui rêve, qui ose, qui se relève et qui transforme par sa résilience. » Pour UNFPA, l'objectif de cette expansion nationale est ambitieux : atteindre 10 000 filles dans 500 écoles à travers la RDC. Selon Alain AKPADJI, l'ALF est un mouvement national dédié à révéler, former et propulser les futurs leaders féminins de la RDC. Tout en exprimant sa gratitude envers la Norvège et la Suède pour leur soutien constant aux interventions visant le renforcement du leadership des jeunes en RDC, le Représentant de UNFPA affirme que cette initiative innovante a été mise en place afin de renforcer la confiance en soi, les compétences intellectuelles et le leadership des jeunes filles congolaises.
1 / 5

Histoire
11 décembre 2025
Le FIDA et le FEM s’engagent à restaurer 9000 hectares de terres boisées des Paysages du Miombo
Un atelier de lancement du nouveau projet « Gestion intégrée durable et adaptative des ressources naturelles pour soutenir la restauration des écosystèmes et les moyens de subsistance dans les paysages du Miombo » s’est tenu du 20 au 21 novembre 2025 à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Organisé dans le cadre de l’extension du Projet AVENIR, cet atelier marque une étape importante pour la mise en œuvre d’une initiative ambitieuse financée par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM/GEF) et par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA).Ce projet vise notamment la restauration de 9 000 hectares de terres boisées du Miombo, un écosystème essentiel mais fortement menacé par la déforestation, la pression agricole et les changements climatiques. Grâce à cette intervention, les partenaires entendent renforcer la résilience écologique des zones ciblées et soutenir les moyens de subsistance des communautés locales à travers des pratiques de gestion durable.Au cours de l’atelier, les participants ont été familiarisés avec les objectifs et résultats attendus du Child Project, ses activités phares ainsi que son dispositif de mise en œuvre. Les échanges ont porté sur l’intégration des exigences environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) du FEM, l’harmonisation des outils de gestion et l’inclusion des activités du GEF dans le Plan de travail et budget annuel 2026 du Projet AVENIR.Les autorités provinciales du Lualaba ont salué l’importance de cette initiative environnementale dans une province majoritairement connue pour son secteur minier. Elles ont souligné le rôle clé que jouera le territoire de Mutshatsha, retenu comme zone pilote pour les activités de restauration des paysages dégradés.Pour le Coordonnateur national du Projet AVENIR, cette extension représente « un levier essentiel pour approfondir la gestion intégrée des ressources naturelles » et renforcer l’impact du projet dans les nouvelles zones d’intervention. Les partenaires ont également insisté sur la nécessité de renforcer les synergies avec d’autres programmes nationaux afin d’amplifier les effets positifs de la restauration dans les paysages du Miombo.Cette nouvelle phase du Projet AVENIR ouvre ainsi la voie à une action environnementale renforcée, intégrée et durable au service des communautés du Sud-Kwango, du Haut-Katanga et du Lualaba.
1 / 5

Histoire
11 décembre 2025
Mariane Kimingu, Femme maraîchère et bénéficiaire du projet AVENIR
''Avec l’appui du Projet Avenir, nous avons multiplié nos rendements.'' témoigne-t-elle avec fierté. Les formations reçues notamment sur le labourage, le ménage cultural et le grattage lui ont permis d’adopter de meilleures techniques de production et d’obtenir des résultats concrets sur son exploitation.Elle rappelle l’importance de l’accès aux semences améliorées et quelques défis:''les semences améliorées qui ont été mise à notre disposition par le projet AVENIR , nous ont permis de multiplier nos rendements mais cette année, notre difficulté a été le retard des pluies''Malgré ces défis, Mariane reconnaît que l’impact du projet est réel et transformateur. Les connaissances acquises, la structuration des producteurs et l’amélioration des pratiques agricoles constituent autant d’atouts pour renforcer sa résilience et celle de son union.L’histoire de Mariane illustre parfaitement comment l’appui du Projet Avenir contribue à renforcer les capacités des femmes productrices, améliorer la productivité locale et soutenir l’autonomisation économique dans les zones rurales du Congo.L’objectif global du projet Autonomisation par la valorisation de l’entrepreneuriat agricole et rural sensible à la nutrition, inclusif et résilient (AVENIR) est de contribuer à la réduction de la pauvreté rurale et à l’amélioration de la nutrition des populations rurales des provinces entourant Kinshasa. Son objectif de développement est de soutenir une transformation durable de l’agriculture familiale et une meilleure gestion des ressources naturelles afin de contribuer à l’atténuation des effets des changements climatiques, à l’amélioration des revenus et à la diversité alimentaire des ménages ruraux.
1 / 5

Histoire
09 décembre 2025
Quand la jeunesse congolaise rencontre l’ONU : une visite qui ouvre des horizons
La République démocratique du Congo a vécu, fin novembre 2025, un moment inédit avec la visite de Felipe Paullier, Sous-Secrétaire général des Nations Unies pour la jeunesse. Dès son arrivée à Kinshasa, le ton était donné : écouter, comprendre et dialoguer avec la jeunesse congolaise pour bâtir des passerelles vers un avenir inclusif et durable.Au Musée national, le mini-dialogue intergénérationnel a réuni des jeunes venus de Kinshasa, des provinces et même du niveau régional, aux côtés de personnalités clés comme la Ministre de la Jeunesse et de l’Éveil patriotique, Grâce Kutino, la Conseillère spéciale du Chef de l’État, Chantal Yelu, et le Coordonnateur résident du Système des Nations Unies, Bruno Lemarquis. Cette rencontre, organisée par le Gouvernement à travers le Conseil national de la jeunesse, a permis de mettre sur la table les aspirations, les frustrations et les recommandations des jeunes. Bruno Lemarquis a ouvert le débat en saluant l’engagement des parties prenantes et en rappelant l’urgence d’impliquer les jeunes dans tous les domaines, y compris les processus internationaux. « Investir dans la jeunesse, c’est assurer le développement durable », a-t-il affirmé, réitérant l’appui du Système des Nations Unies pour renforcer leur participation aux décisions.La Conseillère du Président a reconnu la légitimité des frustrations liées à l’exclusion des jeunes et a appelé à des solutions concrètes pour leur intégration dans l’action gouvernementale. Grâce Kutino, pour sa part, a mis en avant des avancées majeures : la création du Secrétariat technique national 2250, la validation du Plan d’action national et le renforcement des plateformes multisectorielles. Elle a annoncé la tenue prochaine d’un marché des opportunités pour offrir aux jeunes un espace d’expression et d’échange sur les opportunités d’exploitation de leurs potentiels, en vue de leur autonomisation.Felipe Paullier, quant à lui, a rappelé que sa mission consistait avant tout à écouter et à comprendre les réalités vécues par la jeunesse congolaise. « Le monde s’oriente vers le changement porté par la jeunesse », a-t-il déclaré, réaffirmant l’engagement de l’ONU à soutenir le gouvernement pour que les jeunes soient entendus et représentés. Il a aussi mis à profit sa visite pour échanger avec de jeunes parlementaires pour comprendre leurs priorités et renforcer leur rôle dans l’inclusion des jeunes. Sa rencontre avec des acteurs du secteur privé a porté sur comment promouvoir des partenariats économiques et des modèles de dialogue public-privé. En articulant ces deux démarches, Paullier a souligné la complémentarité entre volonté politique et dynamisme entrepreneurial, indispensables pour créer des emplois, stimuler l’innovation et accélérer la transformation durable du pays. ‘’Les jeunes n’ont pas besoin de la compassion, mais des opportunités’’, a souligné le Sous-Secrétaire Général en charge de la jeunesse, lors du dîner avec le secteur privé.Après Kinshasa, la visite s’est poursuivie dans le Haut-Katanga, où Paullier a découvert des initiatives concrètes qui changent des vies. À Kipushi, il a rencontré Rachel, l’une des plus de 150 jeunes filles réinsérées grâce à un projet de l’UNICEF visant la formation professionnelle des filles sorties des mines. Devenue couturière, Rachel encadre aujourd’hui d’autres jeunes filles, illustrant la puissance de l’autonomisation.À Lubumbashi, Paullier s’est rendu au Centre d’Excellence de l’INPP, soutenu par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), où plus de 1 400 jeunes (15% des femmes) sont formés à la maintenance des engins lourds et des véhicules commerciaux grâce au Projet d’Appui à la Formation et à l'Emploi Qualifié (PAFEQ), en partenariat avec Volvo, Epiroc et SMT. Cette initiative incarne la synergie entre les Nations Unies et le secteur privé pour créer des opportunités d’emploi durable.La visite s’est également enrichie d’un dialogue avec les jeunes du Haut-Katanga autour de la paix, de la cohésion sociale et de l’inclusion. Les participants ont insisté sur la nécessité de former des Ambassadeurs de la Paix, de créer des centres d’autonomisation et d’inclure systématiquement les jeunes dans les politiques publiques. Paullier a écouté attentivement leurs préoccupations, notamment la lutte contre les discours de haine, la protection des personnes vulnérables et la préservation de l’environnement dans un contexte marqué par l’activité minière.Au fil des échanges, un constat s’impose : la RDC dispose d’une jeunesse engagée, créative et capable de transformer le pays. Mais les défis restent nombreux : accès limité aux financements, manque de structures d’accompagnement entrepreneurial, faible culture de l’entrepreneuriat. Les jeunes ont formulé des recommandations fortes, allant de la matérialisation de l’accompagnement institutionnel à la mise en place d’une politique incitative pour l’entrepreneuriat. Cette visite marque une étape décisive dans la collaboration entre la jeunesse congolaise, le gouvernement et les Nations Unies. Elle a permis de faire entendre la voix des jeunes, de partager leurs priorités et de réaffirmer l’engagement des institutions nationales et internationales à travailler avec eux pour bâtir une RDC plus inclusive, plus stable et tournée vers l’avenir. Comme l’a souligné Felipe Paullier : « Ce n’est pas seulement une rencontre, c’est le début d’un processus pour que la jeunesse soit au cœur des décisions qui façonnent son avenir ».
1 / 5

Histoire
08 décembre 2025
Kinshasa : Trois jours pour plus de cohérence et de coordination des projets PBF
Kinshasa, du 25 au 27 novembre 2025 des voix venues des ministères, des agences onusiennes et des ONG se sont mêlées autour d’un atelier de renforcement des capacités en Suivi & Évaluation (S&E) et de revue du cadre des résultats du portefeuille du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF), pour la période 2025-2029. L’atelier, organisé par le Secrétariat du PBF, n’était pas qu’un simple rendez-vous technique ; il marquait une étape décisive dans la construction d’un cadre de résultats global pour le nouveau cycle du fond (2025-2029), une ambition qui dépasse les projets isolés pour créer une dynamique cohérente et partagée entre acteurs étatiques, humanitaires, de développement et de paix.À la suite de l’approbation de la nouvelle éligibilité de la RDC au PBF pour la période 2025-2029, correspondant à la quatrième phase d’investissement, le Secrétariat PBF a engagé un processus collaboratif pour élaborer le tout premier cadre de résultats global du portefeuille. Celui-ci s’appuie sur la Théorie de Changement incluse dans la demande de l’éligibilité de la RDC au Fonds transmise par le Président de la République au Secrétaire General des Nations unies en décembre 2024. Se référant à l’appel du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies pour ‘’mettre l’État au centre’’, il est important de souligner que la nouvelle éligibilité de la RDC au PBF exige une approche plus programmatique. Autour des tables, les discussions ont porté sur les cibles, les moyens de vérification, les hypothèses et les risques, mais aussi sur la responsabilité collective dans la collecte des données. Ce n’était pas qu’une question de chiffres : c’était une question de vision.Les discussions ont mis l’accent sur les cibles, les moyens de vérification, les hypothèses, les risques, ainsi que les responsabilités en matière de collecte des données. ‘’Cet atelier renforce substantiellement nos capacités en évaluation d’impact’’, a témoigné Monsieur Mugisha Tshikanza, Directeur des Études et Planification (DEP) du Sénat, avant de recommander l’allocation de lignes budgétaires nationales pour pérenniser ces acquis. Gage d’une appropriation parfaite des initiatives, Monsieur Rachidi Kapezi, DEP au Ministère de la Justice, salue ‘’la nature participative du processus PBF, qui permet aux bénéficiaires de contribuer directement à la définition des axes d’intervention’’. Motivées par le souci de garantir une durabilité efficace des interventions, les ONG récipiendaires insistent sur la régularité d’assises de coordination : ‘’Nous recommandons la tenue semestrielle de tels ateliers pour assurer un suivi continu et une meilleure cohérence des interventions’’, a plaidé Mme Inès Banzi Kabeya, de Search for Common Ground. Les agences onusiennes partagent cet enthousiasme. ‘’Nous avons désormais une compréhension commune du cadre des résultats et des outils adaptés aux réalités du terrain‘’, a affirmé Sylvain Mabika, de l’ONU-Femmes, saluant la capacité du Secrétariat PBF à conjuguer rigueur et flexibilité.Trois jours d’échanges, de débats et de recommandations qui posent les fondations d’un cadre solide pour accompagner les priorités de consolidation de la paix en RDC. Les conclusions seront présentées lors du prochain Comité de Pilotage Conjoint en décembre, mais déjà, une conviction se dessine : la paix ne se décrète pas, elle se construit, pas à pas, avec des outils, des idées et surtout des femmes et des hommes engagés.
1 / 5

Communiqué de presse
09 décembre 2025
Lancement du mécanisme de coordination Nexus Humanitaire–Développement–Paix (Nexus-HDP) en RDC
Ce mécanisme national est chargé d’assurer le pilotage de l’approche Nexus HDP Humanitaire - Développement - Paix par le Gouvernement national en mobilisant l’action publique et en renforçant le dialogue et la concertation entre l’Etat et les acteurs intervenant dans les domaines humanitaires, du développement et de la paix en RDC. Face aux crises multiples et prolongées qui exigent des réponses intégrées et dans un contexte de diminution de l’aide publique au développement et du financement humanitaire, le GCN-HDP vise à renforcer la coordination, la cohérence et la complémentarité des actions menées dans les trois piliers du Nexus HDP. Ce mécanisme opérationnalise une coordination au niveau central, capable d’appuyer les dynamiques provinciales, d’assurer un suivi stratégique des interventions Nexus et de favoriser une meilleure efficacité des investissements. « Sa création marque une avancée décisive vers une action publique plus cohérente, plus efficace et mieux alignée sur les priorités nationales. Il constitue un levier stratégique pour assurer un portage politique fort et un ancrage institutionnel au plus haut niveau de l’approche Nexus, en alignement avec le Plan National de Développement Stratégique. Dans un contexte de contraction de l’aide au développement, c’est également une approche qui vise à maximiser l’impact des investissements » a souligné le Ministre d’État, Ministre du Plan et de la Coordination de l’Aide au Développement, Son Excellence Monsieur Guylain Nyembo.« L’approche Nexus HDP, loin d’être un simple concept, représente un véritable changement de paradigme : elle vise à réduire les vulnérabilités et les besoins humanitaires en s’attaquant aux causes sous-jacentes des crises, grâce à des actions simultanées et complémentaires », a déclaré le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies, Monsieur Lemarquis, en ajoutant que « sur la base des leçons apprises jusqu’à présent en RDC, il convient maintenant d’assurer un passage à l’échelle de l’approche nexus, pour avoir un véritable impact, par exemple en ce qui concerne les solutions durables pour les personnes déplacées lorsque le contexte le permet. Ce passage à l’échelle ne peut se faire sans avoir l’Etat au centre et la pleine mobilisation de la puissance publique au niveau central et provincial, et de tous les partenaires HDP. Le GCN-HDP offre un cadre pour cela,» a -t-il conclu. La cérémonie officielle a été marquée par les allocutions du Ministre d’État, Ministre du Plan et de la Coordination de l’Aide au Développement, et celle du Coordonnateur Résident des Nations Unies. Elles ont été suivies d’un panel avec les représentants des ministères sectoriels, sur chacun des piliers du Nexus HDP, sous le leadership du Ministre d’Etat, Ministre du Plan et de la Coordination de l’Aide au Développement et le Coordonnateur Résident. Les participants ont également échangé sur des opportunités, défis et perspectives du Nexus HDP en RDC.
1 / 5
Communiqué de presse
09 septembre 2025
Le gouvernement de la RDC et la coopération allemande renforcent leur collaboration afin de promouvoir la paix, la cohésion sociale et le développement durable
Le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) et la KfW Banque de Développement (coopération financière allemande) ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de financement de 54,3 millions d'euros pour le projet "Fonds de Consolidation pour la Paix III". Cette initiative de cinq ans vise à promouvoir une paix durable, la cohésion sociale et le développement durable dans les provinces de l'est de la République démocratique du Congo (RDC) touchées par les conflits, et à prévenir la violence juvénile à Kinshasa. Ce projet a pour ambition de bénéficier directement à plus de 650 000 personnes dans les provinces de l'est et à Kinshasa.''Nous saluons la signature de cet accord, qui consolide notre partenariat de longue date avec l'Allemagne et le système des Nations unies », a déclaré S.E.M. Guylian Nyembo, Ministre d'Etat, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement. ''Ce projet est un jalon majeur qui s'aligne stratégiquement sur les priorités du Programme de Développement Local des 145 Territoires, en se concentrant sur le développement des infrastructures socio-économiques de base et la redynamisation des économies locales. En ciblant les zones post-conflits dans l'est et la prévention de la violence juvénile à Kinshasa, cette initiative répond directement aux axes stratégiques de notre Cadre de coopération pour le développement durable 2025-2029. Le gouvernement de la RDC réitère son engagement à jouer un rôle central dans la coordination de ces efforts pour garantir que les investissements internationaux se traduisent par des résultats palpables et durables pour nos communautés''.Pour la première fois en Afrique, la KfW finance directement un projet mis en œuvre par l’UNOPS. L'UNOPS, en tant que principal agent de mise en œuvre, sera responsable de la coordination globale, des composantes d'infrastructure et de la gestion financière. L’UNOPS collaborera dans le cadre de cet accord avec Interpeace, en tant qu'expert en matière de paix, qui sera chargé de veiller à ce que la consolidation de la paix, la cohésion sociale et l'inclusion des genres soient intégrées à toutes les phases du projet.
''Nous sommes fiers de soutenir cette initiative vitale en RDC », a déclaré Jonas Blume, Chef de Division, KfW. « Le projet Fonds de la paix est un excellent exemple de la manière dont des investissements ciblés peuvent contribuer à la fois à la réduction de la pauvreté et à la résolution des conflits locaux. L'accent mis sur la proactivité pour la paix et les solutions communautaires s'aligne parfaitement sur notre engagement à parvenir au développement durable dans des contextes fragiles. Cette initiative visant à soutenir le processus de stabilisation en RDC s'inscrit dans l'un des trois principaux axes de collaboration de la coopération bilatérale RDC-Allemagne: Paix et cohésion sociale''.Le projet Fonds de la paix est structuré en deux composantes principales:Fonds de Consolidation pour la Paix III (FCP III) : axé sur l'est de la RDC, ce volet vise à construire des infrastructures sociales et économiques (écoles, marchés, cliniques) et à renforcer les capacités de résolution des conflits. Il créera des emplois et des revenus pour les populations vulnérables.Prévention de la violence juvénile (PVJ) : à Kinshasa, ce volet cible les jeunes des communes de Ngaliema et Masina. Il prévoit de construire des infrastructures sociales comme des terrains de sport, et de proposer des formations professionnelles et un soutien à l'entrepreneuriat.''C'est plus qu'un projet; c'est un investissement dans la population de la RDC », a déclaré Nathalie Angibeau, Directrice de l'UNOPS pour l'Afrique centrale. « En donnant aux communautés les moyens de mener leurs propres eff orts de consolidation de la paix, nous les aidons à créer l'avenir stable et prospère qu'elles méritent. Notre partenariat avec la KfW et Interpeace nous permet de lier les besoins urgents en infrastructures à une vision à long terme de la paix et de la résilience''.“Interpeace se réjouit profondément de l’opportunité de collaborer avec le gouvernement de la RDC, et de l‘Allemagne au travers de la KfW et UNOPS dans le cadre de ce projet stratégique visant à renforcer la cohésion sociale entre les communautés dans les zones d’intervention” a declaré Mr Itonde Kakoma, Président et CEO de Interpeace. “Cette collaboration reflète notre engagement commun à promouvoir la paix durable à travers des approches inclusives et participatives”.La stratégie du projet est conçue pour rapprocher les communautés, en favorisant le dialogue et des interactions pacifiques de part et d’autre des lignes de conflit. Elle utilisera un processus participatif pour sélectionner des sous-projets basés sur des intérêts collectifs et impliquera activement les femmes et les jeunes à toutes les phases de la mise en œuvre pour assurer leur autonomisation et leur leadership. Le projet s'engagera également avec les autorités gouvernementales et la société civile pour assurer la durabilité et l'alignement avec les stratégies nationales de paix.
''Nous sommes fiers de soutenir cette initiative vitale en RDC », a déclaré Jonas Blume, Chef de Division, KfW. « Le projet Fonds de la paix est un excellent exemple de la manière dont des investissements ciblés peuvent contribuer à la fois à la réduction de la pauvreté et à la résolution des conflits locaux. L'accent mis sur la proactivité pour la paix et les solutions communautaires s'aligne parfaitement sur notre engagement à parvenir au développement durable dans des contextes fragiles. Cette initiative visant à soutenir le processus de stabilisation en RDC s'inscrit dans l'un des trois principaux axes de collaboration de la coopération bilatérale RDC-Allemagne: Paix et cohésion sociale''.Le projet Fonds de la paix est structuré en deux composantes principales:Fonds de Consolidation pour la Paix III (FCP III) : axé sur l'est de la RDC, ce volet vise à construire des infrastructures sociales et économiques (écoles, marchés, cliniques) et à renforcer les capacités de résolution des conflits. Il créera des emplois et des revenus pour les populations vulnérables.Prévention de la violence juvénile (PVJ) : à Kinshasa, ce volet cible les jeunes des communes de Ngaliema et Masina. Il prévoit de construire des infrastructures sociales comme des terrains de sport, et de proposer des formations professionnelles et un soutien à l'entrepreneuriat.''C'est plus qu'un projet; c'est un investissement dans la population de la RDC », a déclaré Nathalie Angibeau, Directrice de l'UNOPS pour l'Afrique centrale. « En donnant aux communautés les moyens de mener leurs propres eff orts de consolidation de la paix, nous les aidons à créer l'avenir stable et prospère qu'elles méritent. Notre partenariat avec la KfW et Interpeace nous permet de lier les besoins urgents en infrastructures à une vision à long terme de la paix et de la résilience''.“Interpeace se réjouit profondément de l’opportunité de collaborer avec le gouvernement de la RDC, et de l‘Allemagne au travers de la KfW et UNOPS dans le cadre de ce projet stratégique visant à renforcer la cohésion sociale entre les communautés dans les zones d’intervention” a declaré Mr Itonde Kakoma, Président et CEO de Interpeace. “Cette collaboration reflète notre engagement commun à promouvoir la paix durable à travers des approches inclusives et participatives”.La stratégie du projet est conçue pour rapprocher les communautés, en favorisant le dialogue et des interactions pacifiques de part et d’autre des lignes de conflit. Elle utilisera un processus participatif pour sélectionner des sous-projets basés sur des intérêts collectifs et impliquera activement les femmes et les jeunes à toutes les phases de la mise en œuvre pour assurer leur autonomisation et leur leadership. Le projet s'engagera également avec les autorités gouvernementales et la société civile pour assurer la durabilité et l'alignement avec les stratégies nationales de paix.
1 / 5
Communiqué de presse
01 août 2025
Les Nations Unies appellent à l’engagement de tous à s’attaquer aux normes sociales limitant l’égalité des sexes et à défendre le droit fondamental à une éducation de qualité pour tous et toutes.
‘’Garantir le droit inaliénable à l'éducation pour toutes les filles, y compris celles confrontées à une grossesse, constitue une pierre angulaire de l'égalité des sexes et le développement durable. Trop longtemps, des normes sociales restrictives et des violences ont compromis l’avenir éducatif de nombreuses jeunes filles, les empêchant de réaliser pleinement leur potentiel. Ces nouvelles mesures marquent une avancée décisive vers plus de justice et d’autonomisation.’’ a déclaré le Coordinateur résident ai, Monsieur John Agbor.Cette directive vise à garantir l’accès équitable à l’éducation pour toutes les élèves et ne laisser pour compte, principe fondamental pour lutter contre les discriminations. Elle répond à une problématique persistante dans laquelle des filles se voyaient exclues du système scolaire en raison d’une grossesse. Il s’agit d’un progrès majeur, d’autant plus que ces grossesses sont souvent liées à un manque d’autonomie corporelle, à une information insuffisante, ainsi qu’à des actes de violence et d’agression sexuelle dont elles sont victimes.Permettre à chaque adolescente de développer pleinement son potentiel est un levier essentiel pour le développement durable. L'égalité des sexes est un catalyseur clé de l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD), et beaucoup reste à faire. Les ODD 1 (pauvreté), 3 (santé et bien-être), 4 (éducation de qualité), 5 (égalité entre les sexes), 8 (travail décent et croissance économique), 10 (réduction des inégalités), et 16 (paix, justice et institutions efficaces) sont étroitement liés à l’autonomisation des femmes et des filles. Le Cadre de Coopération pour le Développement Durable (CCDD) 2025-2029 des Nations Unies en RDC met l'accent sur l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base de qualité, une protection sociale inclusive et au renforcement des capacités pour tous et toutes, en particulier les plus vulnérables. L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes sont parmi les principes directeurs de la mise en œuvre du CCDD, qui reconnait que les femmes sont victimes d'inégalités juridiques, politiques, économiques et sociales, ainsi que de violences basées sur le genre (VBG). L'amélioration du faible niveau d'éducation et de formation des filles est explicitement prise en compte dans les résultats stratégiques du CCDD.Les Nations Unies, en collaboration avec les partenaires, appuient le gouvernement de la RDC à œuvrer activement pour le maintien des filles à l'école et leur autonomisation. Cela passe par des programmes de renforcement des capacités, la promotion du leadership féminin, l’accès à une éducation inclusive et à l’information et les services sur la santé sexuelle et reproductive, ainsi que par l'amélioration de la collecte et de l’utilisation des données démographiques grâce à l’Enquête Démographique et de Santé (EDS-III), au renforcement des capacités de l’Institut National de la Statistique (INS), au système d’information et de gestion (SIGE) du secteur de l’éducation, et au Système d'Information Sanitaire (SIS-DHIS2). Les Nations Unies appellent également la société civile à jouer un rôle actif dans cette dynamique de changement, en s’attaquant aux normes sociales limitant l’égalité des sexes et en défendant le droit fondamental à une éducation de qualité pour toutes et tous. **** Fin****
1 / 5
Communiqué de presse
20 mai 2025
Communiqué Conjoint sur la mise en œuvre du nexus humanitaire, développent et paix (HDP) dans la province du Kasaï
La province du Kasaï a tenu son ‘’Dialogue stratégique pour le renforcement de l’approche Nexus avec l’Etat au centre’’, à Tshikapa, du 14 au 15 mai 2025. Faisant suite à la relance de l’approche nexus HDP par le Gouverneur de province, les présents travaux ont connu la participation du Vice-Gouverneur et Gouverneur intérimaire, du Vice-Président et Président intérimaire de l’Assemblée Provinciale, des Députés provinciaux, des ministres provinciaux, de la délégation conjointe du Ministère du Plan et de la Coordination de l’Aide au Développement, conduite par le Secrétaire Général, des représentants du groupe de bailleurs du Nexus, notamment les Ambassades d’Allemagne, de Belgique, de Suède, et du Bureau du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies. Ces assises ont été une opportunité d’échanger avec les acteurs du terrain, à savoir les représentants du système de Nations Unies, de la société civile, du secteur privé, des ONGs nationales et internationales, ainsi que les experts et chefs de division de l’administration publique, sur les résultats concrets de l’approche Nexus HDP et les approches de travail pour aligner les efforts autour du plan de développement provincial du Kasaï, comme cadre stratégique fédérateur.La composition de la délégation conjointe et la participation au niveau de la province se révèlent une occasion historique, réunissant le gouvernement central, les partenaires techniques et financiers, le gouvernement provincial, le système des Nations Unies et la société civile, dans une province pilote, où l’approche Nexus est mise en œuvre depuis 2022. Cette approche intégrée a déjà permis d’enregistrer des résultats concrets, notamment une réduction mesurable de l’insécurité alimentaire, une augmentation de l’accès aux services sociaux de base et une baisse des cas de violences basées sur le genre.Afin d’avoir un aperçu de ces résultats, la délégation a également visité une intervention qui s’inscrit dans les efforts engagés par le gouvernement dans le cadre du projet de justice transitionnelle ‘’PROJUST’’. Ce projet soutenu par le Fonds pour la consolidation de la paix (PBF), lancé récemment, capitalise sur des interventions antérieures visant la réconciliation communautaire et la formation des réseaux des femmes championnes dans la promotion de la cohésion sociale ; il illustre de manière concrète l’opérationnalisation du Nexus dans le contexte local. La délégation a également eu l’opportunité de visiter le pôle de convergence de Shamusanda, afin de découvrir une autre initiative concrète mise en œuvre à travers l’approche Nexus. Cette initiative, menée conjointement par le HCR, la FAO et le PAM, intègre des mécanismes alternatifs de résolution des conflits au sein des communautés bénéficiaires.Il faut rappeler que, dans une perspective de renforcement de la coordination entre les gouvernements central et provincial et leurs partenaires, le Ministère du Plan et de la Coordination de l’Aide au Développement a récemment acté la mise en place d’un Groupe Consultatif Nexus (GCN) pour appuyer l’opérationnalisation de l’approche nexus en lien avec le Plan national stratégique de développement (PNSD) 2024-2028.La dynamique du Kasaï présente des opportunités stratégiques pour continuer la réflexion conjointe sur le renforcement de la collaboration entre les différents acteurs des 3 piliers Humanitaire, Développement et Paix, pour plus de coordination, plus de synergie et plus de complémentarité, afin de générer un impact durable sur le terrain et améliorer les conditions de vie des populations locales à travers une approche intégrée et coordonnée.
1 / 5
Communiqué de presse
12 avril 2025
La République Démocratique du Congo à nouveau éligible au Fonds pour la consolidation de la paix
‘’À travers ce soutien, le Fonds poursuivra son engagement aux côtés du Gouvernement congolais pour renforcer les capacités nationales de consolidation de la paix, en veillant à pérenniser les acquis. L’appui sera mis en œuvre à travers des initiatives portées par l’équipe de pays des Nations Unies et ses partenaires, en alignement avec le Cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable pour la période 2025–2029.’’ Ecrit Antonio Guterres.Le PBF est un mécanisme de financement du Secrétaire Général des Nations Unies visant à contribuer au relèvement en faveur de la consolidation de la paix, à travers le monde. Pour ce qui est de la RDC, les interventions dans le cadre de ce Fonds appuient depuis 2009 le renforcement de la gouvernance, la cohérence des mécanismes de consolidation de la paix et la prévention des conflits.Pour le Système des Nations Unies en RDC, ‘’la rééligibilité de la République Démocratique du Congo au Fonds pour la Consolidation de la Paix constitue un signal fort, soulignant l'importance de maintenir une attention particulière au domaine de la consolidation de la paix dans un contexte financier global complexe. Cette reconnaissance offre un nouvel élan aux efforts que nous déployons, en collaboration avec nos partenaires et aux côtés du Gouvernement, pour soutenir les communautés, notamment les personnes les plus vulnérables. En s’appuyant sur leurs potentiels, ces communautés peuvent mieux aborder les causes profondes des conflits et progresser, grâce aux actions appuyées par le PBF, sur la voie de la paix, condition indispensable à la réalisation des Objectifs de Développement Durable.’’, a dit Monsieur Adama Moussa, Coordonnateur Résident par intérim des Nations Unies en RDC.‘’Je me réjouis de l’aboutissement de ce processus qui donne lieu à un nouveau cycle qui se veut une mise à l’échelle des acquis des cycles précédents avec un engagement structurel plus fort et holistique. Il aura la particularité d’accompagner le gouvernement dans ses efforts en matière de prévention de la violence ainsi que des conflits en mettant l’accent sur la rationalisation des programmes et autres mécanismes existants pour plus d’efficacité’’ a déclaré le Vice-Premier Ministre, ministre du Plan et de la Coordination de l’Aide au Développement, en sa qualité de Co-Président du Comité de Pilotage du PBF.Au cours du cycle passé, de 2019 à 2024, avec 22 projets évalués à 49 millions de dollars américains, le PBF a appuyé des activités dans les provinces du Kasaï, Kasaï Central, Sud-Kivu et Tanganyika, en faveur de la cohésion sociale, la gouvernance locale inclusive, la réintégration communautaire, la prévention des conflits, la transition liée au désengagement de la MONUSCO, ainsi qu‘au programme du gouvernement pour le désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (P-DDRCS).Pour ce nouveau cycle, trois axes prioritaires ont été validés par le Comité de Pilotage du PBF, notamment : Le renforcement de la gouvernance et la cohérence des mécanismes de consolidation de la paix et de prévention des conflits ;Le soutien à la résilience des communautés et populations les plus vulnérables aux conflits en promouvant des solutions durables et en abordant les causes profondes, en particulier celles liées aux ressources naturelles, minières et foncières ;Le renforcement de la protection des civils, la sécurité, les droits humains et la justice, y compris transitionnelle, dans la perspective de la transition liée au désengagement progressif et responsable de la MONUSCO.Selon la procédure habituelle du Fonds, de nouvelles initiatives seront identifiées au fur et à mesure, sur la base des allocations annuelles communiquées par le Bureau d’appui à la consolidation de la paix (PBSO) à New York, sous l’égide des co-présidents du Comité de Pilotage National du PBF en RDC et avec l’appui du Secrétariat Conjoint du PBF basé à Kinshasa.
1 / 5
Dernières ressources publiées
1 / 11
Ressources
10 juillet 2025
Ressources
02 août 2024
1 / 11